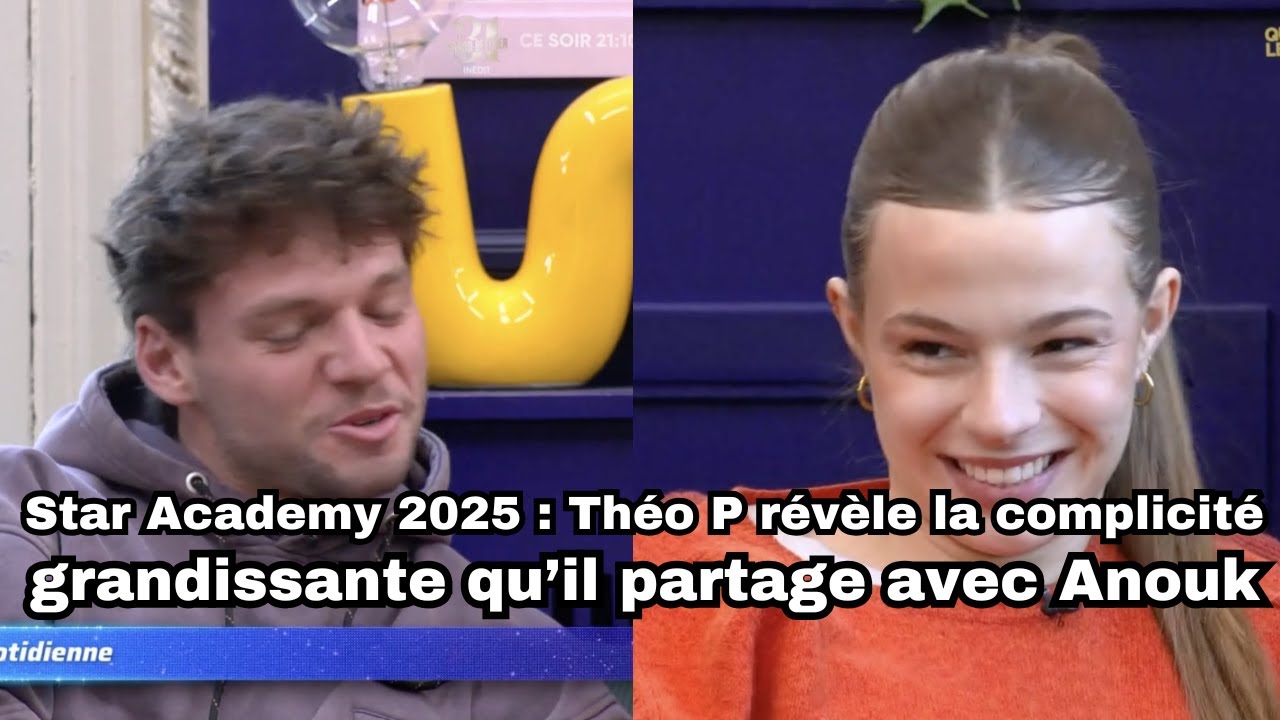Il nous choisissait pour notre pureté, pas pour notre force, pas pour des informations, pas pour notre utilité. Pour notre pureté, comme si nous étions des trophées rares dans une guerre qui dévorait tout sur son passage. Je m’appelle Jeanne Vin, j’ai 86 ans et j’ai passé plus de six décennies à tenter d’effacer de ma mémoire ce que les soldats allemands faisaient aux religieuses prisonnières pendant la Seconde Guerre mondiale. Je n’y suis jamais parvenue. Le souvenir est gravé dans ma chair, dans les odeurs, dans les sons qui résonnent encore. J’étais jeune, j’avais 24 ans. Je portais mon habit avec fierté et je croyais que ma foi suffirait à traverser n’importe quelle obscurité. Je me trompais profondément.

Dans ce camp de prisonniers du nord de la France, j’ai appris qu’il existe des violences qui ne laissent aucune marque visible, mais qui détruisent tout ce qu’on croyait être. J’ai vu des sœurs perdre leur voix avant de perdre leur corps. J’ai vu des femmes saintes réduites à des objets de désir perverti, traitées comme des expériences, comme des jouets réservés aux officiers qui s’ennuyaient. Et j’ai survécu. J’ai été la seule des quinze à revenir. J’ai porté ce fardeau seule pendant toute ma vie. Mais maintenant, avant de mourir, j’ai décidé de parler parce que ce qu’ils nous ont fait ne peut être oublié. Parce que lorsque nous effaçons ces histoires, la violence trouve l’espace pour revenir.
C’était la fin du mois d’octobre 1943 et l’automne arrivait froid et humide dans le centre de la France, près de Clermont-Ferrand, où notre couvent se trouvait caché entre des collines couvertes de brumes et des forêts denses qui semblaient nous protéger du monde extérieur. Nous vivions là depuis des années, quinze religieuses de l’ordre de Notre-Dame de la Miséricorde, dévouées aux soins des oubliés, des enfants orphelins de guerre, des personnes âgées abandonnées, des malades que personne ne voulait plus toucher par peur ou pauvreté. Nous ne possédions pas d’armes, nous ne cachions pas de résistants, nous ne transmettions pas de messages secrets. Nous n’étions que des femmes qui priaient, qui travaillaient et qui croyaient que la neutralité religieuse nous rendrait invisibles aux yeux de l’occupation nazie. Naïveté pure. La guerre ravageait déjà l’Europe depuis quatre ans, mais dans cette région montagneuse, nous vivions encore une sorte d’illusion fragile, comme si les prières créaient un bouclier invisible autour de nos murs de pierres anciennes.
Je me réveillais chaque jour avant l’aube. Je descendais les escaliers étroits jusqu’à la chapelle glacée où l’odeur de l’ancien se mélangeait à la moisissure des murs. Là, agenouillée sur le banc de bois usé, je demandais la protection divine pour nous toutes. Je croyais que Dieu nous voyait, que notre dévouement serait récompensé. Je croyais que l’habit que nous portions nous rendait intouchables. Mais la vérité, c’est qu’il nous marquait, il nous distinguait, il nous transformait en quelque chose de rare et, par conséquent, de désirable pour des hommes qui avaient perdu toute notion d’humanité.
Le matin du 20 octobre, j’ai entendu le bruit des camions militaires qui remontaient la route étroite menant au couvent. C’était un bruit grave, mécanique, qui tranchait le silence matinal comme une lame. J’étais dans la cuisine en train de préparer du pain pour les enfants lorsque sœur Marguerite est entrée en courant, le visage pâle, les yeux écarquillés de terreur. Elle n’a pas eu besoin de dire un mot. Le bruit grandissait, se rapprochait, et nous savions toutes ce que cela signifiait. Nous avons tout abandonné. Nous avons couru à l’étage où se trouvaient les dortoirs des enfants et avons tenté de les cacher dans les armoires, sous les lits, derrière les lourds rideaux qui sentaient le moisi et la naphtaline. Mais il n’y a pas eu de temps. La porte principale a été défoncée dans un fracas qui a fait trembler tout le bâtiment.
En quelques secondes, ils étaient à l’intérieur. Des soldats allemands de la Wehrmacht, jeunes pour la plupart, certains à peine barbus, mais portant des uniformes impeccables et tenant leur fusil comme un outil de travail. Ils crièrent des ordres en allemand, une langue qu’aucune de nous ne maîtrisait complètement, mais le ton était clair, universel. C’était le langage de la violence institutionnalisée. Nous sommes toutes descendues dans la grande salle, les quinze religieuses, et avons été alignées contre le mur de pierre froide, tandis qu’un officier plus âgé aux cheveux grisonnants et au regard méticuleux marchait lentement devant nous, observant chaque visage comme on inspecte du bétail. Il s’est arrêté devant moi, a légèrement incliné la tête et a dit quelque chose en allemand au soldat à côté de lui. Le soldat a ri. C’était un rire court, sec, dépourvu d’humanité. Et à cet instant, sans encore comprendre complètement ce qui se passait, j’ai ressenti pour la première fois ce que c’était d’être vue non pas comme une personne, mais comme un objet.
Nous avons toutes été arrêtées sans accusation formelle, sans jugement, sans droit de contacter qui que ce soit. Ils nous ont poussées dans des camions militaires couverts de bâches sales qui bloquaient complètement la lumière du jour. Nous avons voyagé pendant des heures dans des conditions inimaginables. L’odeur était insupportable : sueur, peur, désespoir. Nous étions serrées les unes contre les autres, ballottées violemment à chaque trou dans la route, essayant de prier à voix basse, mais la vibration du moteur étouffait tout. Sœur Cécile, la plus âgée d’entre nous, avait soixante ans et souffrait de problèmes cardiaques. Elle a commencé à se sentir mal. Elle respirait avec difficulté, transpirait froid. Quand nous avons demandé de l’eau aux soldats qui nous escortaient, ils ont ri de nouveau. Ce rire, je ne l’oublierai jamais. Ce n’était pas de la cruauté explosive, c’était de la cruauté bureaucratique automatisée, comme si notre douleur était un détail sans importance dans un processus plus large qu’ils exécutaient sans questionner.
Nous sommes arrivées au camp de prisonniers en fin d’après-midi. C’était une installation militaire improvisée dans le nord de la France, près de la frontière belge, entourée de barbelés et de tours de guet où des soldats armés de mitrailleuses surveillaient chaque mouvement. Ce n’était pas un camp d’extermination, mais un centre de détention pour prisonniers considérés comme spéciaux, où la violence n’était pas industrialisée mais personnalisée. Ils nous ont immédiatement séparées des prisonnières communes. Nous avons été conduites vers une baraque isolée au fond du complexe, loin des autres bâtiments, cachée derrière une rangée d’arbres qui semblaient avoir été plantés exprès pour bloquer la vue.
À l’intérieur, l’odeur était celle du bois humide, de la terre battue et de quelque chose de chimique qui piquait les yeux. Il y avait quinze lits de fer rouillé, des matelas fins tachés d’urine et de vieux sang, un seau dans le coin servant de toilettes collectives, aucune fenêtre, une seule porte en métal verrouillée de l’extérieur. Dans cette obscurité presque totale, tandis que nous tentions de comprendre ce qui nous arrivait, nous avons entendu pour la première fois ce qui allait se répéter toutes les nuits pendant les mois suivants : les pas lourds qui s’approchaient, la clé qui tournait dans la serrure, la porte qui s’ouvrait lentement et la silhouette d’un officier allemand qui nous observait toutes comme on choisit quelque chose dans une vitrine.
Il est entré lentement, a refermé la porte derrière lui et a dit, en un français cassé mais compréhensible, que nous devions maintenant comprendre notre nouvelle fonction, que nous n’étions plus des religieuses, que Dieu n’était pas là, que la pureté n’existait que tant qu’il le permettait. Puis il a choisi. Il a pointé du doigt sœur Marie-Thérèse, la plus jeune d’entre nous, dix-neuf ans, aux cheveux blonds jamais coupés, au visage angélique sculpté pour représenter la sainteté. Elle a été traînée dehors tandis qu’elle criait, se débattait et implorait la miséricorde. Nous avons essayé de la retenir, mais d’autres soldats sont entrés et nous ont repoussées contre les murs avec les crosses de leur fusil. La porte s’est refermée et nous sommes restées là dans le noir, entendant les cris qui ont commencé forts, désespérés, puis ont diminué jusqu’à devenir des sanglots étouffés. Puis le silence.
Marie-Thérèse est revenue des heures plus tard. Elle n’a rien dit. Elle n’a pas pleuré. Elle a marché jusqu’à son lit, s’est allongée sur le côté face au mur et est restée immobile jusqu’au lever du jour. Son corps était là, mais quelque chose en elle avait été effacé. J’ai appris cette nuit-là qu’il existe des morts qui se produisent sans que le cœur cesse de battre. Et ce n’était que le début. Ce qu’ils lui avaient fait, ils l’ont répété avec nous toutes, nuit après nuit. Ils choisissaient une, parfois deux, ils les emmenaient puis les ramenaient. Nous, qui avions passé notre vie à prier pour la pureté, pour le dévouement divin, pour l’amour du prochain, nous nous sommes vues transformées en expériences de plaisir perverti pour des hommes qui utilisaient notre foi contre nous. L’habit que nous portions, le symbole que nous représentions, tout cela est devenu partie du rituel d’humiliation. Ils voulaient briser le sacré. Ils voulaient prouver que rien n’était intouchable, que même Dieu ne pouvait nous protéger là-bas.
Je me souviens de la première fois où j’ai compris que nous n’étions pas des prisonnières ordinaires, que notre condition de religieuse nous plaçait dans une catégorie particulière, quelque chose de précieux et de méprisable à la fois. C’était lors de la deuxième semaine de captivité, un soir où la pluie tambourinait contre le toit de tôle ondulée du baraquement, créant un bruit sourd et monotone qui couvrait presque tous les autres sons. Un officier supérieur est entré, accompagné de trois soldats plus jeunes qui le suivaient comme des apprentis observant un maître au travail. Il portait un uniforme impeccable, des bottes cirées qui brillaient même dans la pénombre, et ses gestes étaient lents, calculés, comme s’il savourait chaque instant de pouvoir absolu qu’il exerçait sur nous. Il s’est arrêté au centre de la pièce et a allumé une cigarette dont la fumée âcre s’est mêlée à l’odeur de moisi et de peur qui imprégnait déjà l’air.
Il a commencé à parler en français avec un accent lourd mais compréhensible. Il nous a expliqué que notre présence dans ce camp n’était pas un hasard, que nous avions été sélectionnées précisément parce que nous étions religieuses, que nous représentions quelque chose de pur dans un monde en décomposition, et que cette pureté devait être testée, éprouvée, détruite si nécessaire. Il a dit que la guerre changeait les règles, que Dieu lui-même semblait avoir abandonné l’Europe et que si Dieu nous avait abandonnées, alors nous appartenions désormais à ceux qui avaient le pouvoir de décider de notre sort. Ces mots tombaient comme des pierres dans un puits sans fond, résonnant dans le silence terrifié que nous maintenions toutes. Pendant qu’il parlait, son regard parcourait lentement chacune d’entre nous, s’attardant sur nos visages et nos corps cachés sous les habits déchirés comme s’il évaluait une marchandise.
Cette nuit-là, ils ont emmené trois d’entre nous en même temps : sœur Bernadette, 32 ans, d’une famille paysanne de Bretagne ; sœur Élise, 26 ans, ancienne institutrice ayant rejoint l’ordre après la mort de son fiancé ; et moi. Ils nous ont fait sortir dans la nuit froide et humide, nous ont conduites à travers un dédale de baraquements faiblement éclairés par des lampes à pétrole jusqu’à un bâtiment plus grand, apparemment le quartier des officiers. À l’intérieur, il faisait étonnamment chaud, presque étouffant, un contraste violent avec le froid mordant de l’extérieur. Il y avait un poêle à bois dans un coin, des meubles volés à des maisons françaises, un canapé en velours rouge foncé qui jurait avec le reste du décor militaire, des bouteilles de vin alignées sur une étagère et, au mur, un portrait du Führer nous observant de son regard statique.
Quatre officiers étaient assis autour d’une table où traînaient des cartes de jeu, des verres à moitié vides et des cendriers débordants. Ils nous ont regardées entrer comme on regarde un spectacle attendu. Et l’un d’eux, un homme d’une quarantaine d’années avec des cicatrices sur le visage et des mains énormes, s’est levé lentement et a marché vers moi en souriant. Ce sourire était pire que n’importe quelle menace verbale. C’était un sourire de propriétaire, de quelqu’un qui sait qu’il peut faire absolument ce qu’il veut sans conséquence. Il a tendu la main, a touché mon visage, a passé ses doigts rugueux le long de ma joue et a murmuré quelque chose en allemand que je n’ai pas compris, mais dont le ton était suffisamment clair.
Ce qui s’est passé ensuite, je l’ai raconté seulement une fois dans ma vie, à un psychiatre militaire américain en 1946, juste après ma libération. Et même à lui, je n’ai pas pu tout dire. Il y a des mots qui n’existent pas pour décrire certaines expériences. Il y a des violences qui échappent au langage parce qu’elles détruisent précisément la capacité de nommer, de structurer, de donner un sens. Ce que je peux dire, c’est que j’ai appris cette nuit-là que le corps traumatisé peut survivre à des choses que l’esprit refuse d’accepter, que l’âme peut se fragmenter en morceaux pour protéger ce qui reste de soi, et que la prière devient parfois une forme de folie nécessaire pour ne pas sombrer complètement. Je récitais le Notre Père en boucle dans ma tête, les yeux fermés si fort que je voyais des étoiles danser dans l’obscurité intérieure de mes paupières, et je m’imaginais ailleurs, dans la chapelle du couvent, agenouillée devant l’autel, sentant l’odeur de l’encens, le chant grégorien résonnant contre les voûtes de pierre.
Mais la réalité revenait toujours brute, inévitable, sous forme de douleur physique, de poids sur le corps, de souffle alcoolisé contre le visage, de rires étouffés des autres officiers qui observaient en fumant et en buvant comme s’ils assistaient à un divertissement banal. Quand ils ont eu fini avec moi, ils ont commencé avec Bernadette, puis Élise. Nous sommes restées là jusqu’à l’aube et, quand ils nous ont finalement ramenées au baraquement, le soleil se levait déjà, pâle et froid, éclairant un monde qui ne ressemblait plus à celui que j’avais connu. Les jours suivants se sont transformés en une routine cauchemardesque où le temps perdait tout sens, où les nuits et les jours se confondaient dans une succession infinie d’humiliations méthodiques.
Nous avons appris à reconnaître les signaux, les moments où ils viendraient, les types d’officiers qui préféraient telle ou telle parmi nous. Certains aimaient les plus jeunes, d’autres les plus âgées. Certains cherchaient de la résistance pour avoir l’excuse de frapper. D’autres préféraient la soumission totale qui leur donnait l’illusion d’un consentement. Il y avait une logique tordue dans tout cela, une hiérarchie invisible que nous avons fini par comprendre pour essayer de survivre. Sœur Marguerite, 40 ans, au visage sévère marqué par des années de travail dur, est devenue la cible d’un capitaine particulièrement sadique qui semblait jouir de briser ce qu’il percevait comme de la fierté. Il la faisait venir chaque nuit, parfois juste pour la regarder se déshabiller et se rhabiller en boucle pendant des heures, la forçant à réciter des prières pendant qu’il se moquait d’elle, lui crachait dessus, la frappait avec une ceinture quand elle hésitait. Marguerite a tenu trois semaines avant de perdre complètement la raison. Un matin, nous l’avons trouvée accroupie dans un coin du baraquement, nue, se balançant d’avant en arrière en marmonnant des fragments de latin qui ne formaient plus aucune phrase cohérente. Elle ne nous reconnaissait plus, ne répondait plus à nos tentatives de la réconforter et, quelques jours plus tard, ils l’ont emmenée. Nous ne l’avons jamais revue. Nous avons appris par un gardien parlant un peu français qu’elle avait été transférée dans un asile psychiatrique militaire quelque part en Allemagne. Morte ou vivante, nous ne l’avons jamais su.
La déshumanisation était progressive, méthodique, presque scientifique dans son application. Ils ne nous donnaient presque rien à manger, juste assez pour nous maintenir en vie, mais dans un état constant de faiblesse qui rendait toute résistance physique impossible. Du pain noir dur comme de la pierre, une soupe claire où flottaient parfois des morceaux de légumes pourris, de l’eau trouble qui nous donnait des crampes d’estomac. Nous avons toutes perdu énormément de poids en quelques semaines. Nos habits devenus trop grands pendaient sur nos corps émaciés. Nos visages creusés prenaient l’apparence de crânes recouverts d’une peau fine et grise.
Mais le pire n’était pas la faim physique, c’était la destruction systématique de notre identité, de tout ce qui nous définissait auparavant. Ils nous interdisaient de prier ensemble, de chanter, de nous réconforter mutuellement. Quand ils nous surprenaient à réciter le rosaire ou à nous tenir la main dans l’obscurité, ils nous séparaient, nous frappaient, nous privaient de la maigre ration de nourriture du lendemain. L’objectif était clair : nous briser non seulement physiquement, mais spirituellement, nous arracher cette foi qui était notre dernière dignité, notre dernier refuge. Et pour certaines d’entre nous, ils ont réussi. Sœur Cécile, la plus âgée, est morte en décembre, officiellement d’une pneumonie, mais en réalité de désespoir, de cette forme particulière de mort où le corps cesse simplement de lutter parce que l’esprit a déjà abandonné. Elle s’est éteinte une nuit pendant son sommeil et, le lendemain matin, ils ont jeté son corps dans une fosse commune sans cérémonie, sans prière, comme on jette un déchet.
L’hiver 1943 fut le plus long et le plus froid que j’aie jamais connu. Non seulement à cause des températures qui descendaient bien en dessous de zéro, transformant notre baraquement en congélateur où nous nous serrions les unes contre les autres pour ne pas mourir de froid pendant la nuit, mais surtout à cause de cette sensation que le temps lui-même s’était arrêté, que nous étions piégées dans une boucle infernale qui ne finirait jamais. Les journées se ressemblaient toutes, grises, interminables, rythmées uniquement par la faim, la peur et les visites nocturnes qui continuaient sans relâche. Certains officiers devinrent des habitués, développèrent des préférences, réclamèrent toujours la même parmi nous comme on commande son plat préféré dans un restaurant. Cette régularité rendait les choses, d’une certaine manière, encore plus insupportables, car elle transformait l’horreur en routine, en banalité, en quelque chose d’attendu et donc d’inéluctable.
Je me souviens d’un jeune lieutenant, peut-être vingt ans, blond aux yeux bleus, qui aurait pu passer pour l’incarnation parfaite de la propagande aryenne et qui me choisissait presque chaque semaine. Il ne parlait jamais, ne me regardait jamais dans les yeux, accomplissait ce qu’il venait faire avec une efficacité mécanique, puis repartait immédiatement comme s’il effectuait une tâche administrative. Cette froideur était d’une certaine manière plus terrifiante que la cruauté ouverte, car elle révélait à quel point nous étions devenues des non-personnes, des objets fonctionnels sans intériorité, sans âme. Mais il y avait aussi des moments rares et précieux où quelque chose d’humain survivait malgré tout. Sœur Anne-Marie, 28 ans, issue d’une famille bourgeoise de Lyon, avait réussi à cacher un tout petit crucifix en bois qu’elle gardait cousu dans l’ourlet de son habit. Chaque nuit, après que les gardes avaient fait leur dernière ronde et que nous étions certaines d’être seules, elle le sortait délicatement et nous le passions de main en main dans l’obscurité, chacune le tenant quelques secondes, le serrant contre sa poitrine, murmurant une prière silencieuse. Ce geste simple, ce petit morceau de bois sculpté qui ne valait rien matériellement, devenait notre ancre, notre preuve que nous existions encore en tant qu’êtres spirituels, que quelque chose en nous résistait malgré tout.
Un soir de janvier 1944, un garde a découvert le crucifix lors d’une fouille surprise. Ils ont retourné tout le baraquement, arraché les matelas, vidé nos maigres possessions et ont fini par trouver ce minuscule objet qu’Anne-Marie tentait désespérément de dissimuler dans sa main fermée. Le garde l’a arraché brutalement, l’a regardé avec un mélange de dégoût et de curiosité, puis l’a jeté par terre et écrasé sous sa botte jusqu’à ce qu’il ne reste que des fragments de bois. Ensuite, il a frappé Anne-Marie avec une telle violence qu’elle a perdu deux dents et est restée inconsciente pendant plusieurs heures. Quand elle s’est réveillée, le premier mot qu’elle a prononcé fut « pardon ». Et ce pardon était adressé non pas à ses bourreaux, mais à nous, comme si elle se sentait coupable d’avoir mis en danger notre dernier lien avec Dieu.
Les semaines passaient et nous étions de moins en moins nombreuses. Sœur Hélène, 35 ans, a tenté de s’échapper en février, profitant d’un moment de confusion pendant un transfert de prisonniers. Elle a couru à travers le camp, pieds nus dans la neige, hurlant des prières en latin, et a presque atteint la clôture avant qu’une rafale de mitrailleuse ne la fauche. Je l’ai vue tomber, son corps projeté en avant par l’impact des balles, le sang rouge vif se répandant sur la neige immaculée, créant une image d’une beauté horrible que je n’ai jamais pu effacer de ma mémoire. Son cadavre est resté là trois jours comme avertissement et nous devions passer à côté chaque fois que nous sortions pour les corvées. Sœur Gabrielle, la plus silencieuse d’entre nous, celle qui n’avait jamais pleuré même lors des pires tortures, s’est pendue en mars avec un morceau de corde qu’elle avait patiemment tressé à partir de fils arrachés à son habit. Nous l’avons découverte au petit matin, suspendue à une poutre, le visage d’une pâleur cadavérique, et même les gardes ont semblé troublés, comme si ce suicide représentait une forme de victoire pour nous, un choix qu’ils ne pouvaient contrôler.
Le printemps 1944 apporta des changements subtils mais perceptibles. Les bombardements alliés devenaient plus fréquents. Nous entendions les sirènes et les explosions lointaines qui faisaient trembler le sol, et nous percevions dans l’attitude des gardes une nervosité croissante, une peur qu’ils ne pouvaient plus dissimuler complètement. Les officiers venaient un peu moins souvent et, quand ils venaient, ils étaient beaucoup plus brutaux, plus pressés, comme s’ils savaient que leur temps était compté et voulaient extraire jusqu’à la dernière goutte de pouvoir avant que tout s’effondre.
En juin 1944, après le débarquement allié en Normandie dont nous n’avons appris l’existence que plusieurs semaines plus tard, le camp est entré dans une phase chaotique où l’organisation militaire stricte a commencé à se désintégrer. Les gardes étaient de moins en moins nombreux, beaucoup avaient été envoyés au front, et ceux qui restaient semblaient perdus, incertains de ce qu’ils devaient faire de nous. Certains prisonniers commençaient à être transférés vers l’est, vers l’Allemagne, dans des conditions encore plus terribles, entassés dans des trains de marchandises sans nourriture ni eau. Nous, les quelques religieuses qui restaient – nous n’étions plus que six à ce moment-là –, avons été laissées dans le baraquement avec une surveillance minimale. C’était à la fois une bénédiction et une nouvelle angoisse, car nous ne savions pas si cet abandon relatif signifiait qu’on nous oublierait ou si l’on prévoyait quelque chose de pire avant de partir.
Un soir d’août, un officier SS que nous n’avions jamais vu auparavant est arrivé au camp avec une petite unité. Il était différent des autres, plus froid, plus méthodique, avec ce regard vide caractéristique de ceux qui ont participé aux pires atrocités et pour qui la mort est devenue une simple formalité administrative. Il a rassemblé tous les prisonniers restants, nous a alignés dans la cour centrale et a commencé une sélection : hommes d’un côté, femmes de l’autre, puis subdivision par âge, par état de santé, par utilité potentielle. Les religieuses ont été mises à part encore une fois, toujours cette catégorie spéciale qui nous suivait comme une malédiction. L’officier SS s’est approché de nous, a consulté un registre et a annoncé que nous serions transférées le lendemain vers une destination non spécifiée. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie, car nous savions toutes ce que signifiaient ces transferts mystérieux. Nous avions entendu les rumeurs sur les camps d’extermination, sur les chambres à gaz déguisées en douches, sur les fosses communes où les corps étaient brûlés par milliers.
Le lendemain matin n’est jamais venu comme prévu. Vers 4 heures, alors que la nuit était encore noire et épaisse, des explosions ont secoué le camp avec une violence inouïe. Les Alliés bombardèrent la zone, ciblant probablement les infrastructures militaires allemandes mais touchant également le camp de prisonniers dans leur progression implacable vers la libération. Le chaos fut instantané et total, un effondrement brutal de l’ordre militaire qui nous maintenait captives. Les baraquements s’effondraient sous les impacts directs. Des structures entières se désintégraient en quelques secondes dans des gerbes de bois éclaté et de métal tordu. Des incendies éclataient partout, créant une lumière orange et dansante qui transformait la nuit en un tableau surréaliste de l’enfer. Les gardes couraient dans tous les sens en hurlant des ordres contradictoires, leur discipline légendaire complètement évaporée face à la menace venue du ciel. Au milieu de cette apocalypse où la terre tremblait sous nos pieds à chaque nouvelle explosion, où l’air lui-même semblait brûler nos poumons, les prisonniers tentèrent de fuir, de se cacher, de survivre à ces quelques minutes qui séparèrent la vie de la mort.
Notre baraquement a été touché par un tir indirect, probablement manqué, visant une cible principale et tombé à quelques mètres seulement de notre prison de bois. L’onde de choc a été si puissante que j’ai senti mes tympans exploser. Un sifflement aigu a envahi ma tête et ne m’a plus quittée pendant des semaines. Une partie du toit s’est effondrée dans un fracas de bois brisé et de tôles tordues qui arrachaient tout sur leur passage, les poutres anciennes craquant comme des vagues géantes sous la pression. La poussière et la fumée envahirent immédiatement l’espace, nous aveuglant, nous étouffant, transformant notre respiration en une lutte désespérée pour aspirer ne serait-ce qu’un peu d’air non saturé de particules. Dans la confusion totale, alors que nous toussions et tâtonnions pour retrouver nos compagnes dans l’obscurité devenue encore plus opaque, la porte qui nous retenait prisonnières fut soufflée par l’onde de choc, arrachée de ses gonds comme si elle n’était qu’un morceau de carton. Nous étions libres, mais libres dans un enfer de feu et de mort où chaque seconde pouvait être la dernière, où la liberté elle-même semblait n’être qu’une illusion cruelle avant l’anéantissement final.
Sœur Louise, qui m’accompagnait depuis le début de cette épreuve et partageait chaque moment de terreur et d’humiliation, m’attrapa la main avec une force surprenante pour quelqu’un dans son état d’épuisement et me cria quelque chose que je n’entendis pas à cause du sifflement dans mes oreilles. Mais je compris, en voyant son bras pointé vers le nord, qu’elle voulait que nous courions vers la forêt qui bordait le camp. Nous avons couru pieds nus sur un sol alternant boue glacée et éclats de verre et de métal, trébuchant sur des débris, des corps de soldats et de prisonniers indifférenciés dans la mort, sur des cratères de bombes encore fumants qui exhalaient une chaleur intense quand nous passions trop près. Mon cœur battait si fort que j’avais l’impression qu’il allait exploser hors de ma poitrine. Mes poumons brûlaient comme si j’inalais du feu pur. Mais la peur, cette peur primitive de survie, nous poussait en avant.
Derrière nous, le camp brûlait dans une symphonie destructrice, illuminant le ciel nocturne d’une lueur orange et rouge qui ressemblait aux peintures médiévales représentant l’enfer. Nous entendions les cris, les explosions continues, le crépitement des munitions qui explosaient dans les entrepôts, créant un fond sonore d’apocalypse qui semblait ne jamais devoir s’arrêter. Nous atteignîmes la lisière de la forêt juste au moment où une nouvelle série d’explosions ravageait ce qui restait du camp. Les arbres nous accueillirent dans leur obscurité protectrice, leurs branches formant un toit naturel au-dessus de nos têtes, nous cachant des avions qui poursuivaient leur travail de destruction. Nous nous enfonçâmes dans les sous-bois, courant sans nous retourner malgré l’épuisement qui pesait sur nos jambes comme du plomb fondu, guidées seulement par l’instinct de mettre le plus de distance possible entre nous et cet endroit maudit. Les branches nous griffèrent le visage et les bras. Les ronces déchiraient ce qui restait de nos habits. Les racines nous faisaient trébucher dans l’obscurité presque totale. Mais nous continuions, animées par cette volonté farouche de survivre après avoir enduré tant d’horreurs.
Nous avons couru ce qui me sembla être des heures, bien que cela ne fût probablement que quelques dizaines de minutes, jusqu’à ce que nos jambes ne puissent plus nous porter et que nous nous effondrions dans une petite clairière où la lumière de la lune perçait faiblement à travers le feuillage. Nous restâmes là, allongées sur le sol humide et froid, nos corps tremblant de façon incontrôlable, non seulement à cause du froid, mais à cause du choc et de l’adrénaline qui commençait à se dissiper, laissant place à la réalisation de ce qui venait de se passer. Nous étions libres. Après des mois de captivité, d’humiliation, de torture psychologique et physique, nous étions libres. Mais cette liberté n’apportait pas la joie que l’on pourrait imaginer. Elle apportait la peur, l’incertitude, la conscience aiguë que nous étions deux femmes seules, affaiblies, sans ressources dans un territoire encore largement contrôlé par les Allemands, sans savoir où aller ni qui pourrait nous aider.
Louise se redressa la première, son visage émacié éclairé par la faible lueur lunaire. Elle dit d’une voix rauque que nous devions continuer à avancer, que rester trop longtemps serait fatal, que les Allemands survivants au bombardement organiseraient certainement des patrouilles pour capturer les prisonniers évadés. Elle avait raison bien sûr, mais nos corps protestaient violemment contre l’idée de se remettre en mouvement. Nous marchâmes pendant des jours qui se fondirent les uns dans les autres dans un brouillard d’épuisement et de faim – peut-être des semaines, je ne sais plus exactement, car le temps avait perdu tout sens, devenu une succession infinie de levers et couchers de soleil que nous observions à travers les arbres. Nous évitions soigneusement les routes, les villages, tout ce qui pouvait abriter des soldats allemands ou des collaborateurs français susceptibles de nous dénoncer. La France était encore largement occupée en août 1944 et se déplacer à travers le territoire était extrêmement dangereux.
Nous nous nourrissions de ce que la forêt offrait : des baies dont nous n’étions même pas sûres de la comestibilité mais que nous mangions parce que l’alternative était de mourir de faim ; des racines arrachées du sol à mains nues ; des champignons qui nous rendirent parfois malades mais nous permirent de continuer un jour de plus ; de l’eau de ruisseau bue directement à la source en priant pour qu’elle ne soit pas contaminée. Nous dormions cachées dans des granges abandonnées quand nous en trouvions, enfouies dans le foin qui nous gardait un peu au chaud et nous cachait des regards, ou sous des ponts où le bruit de l’eau couvrait nos respirations difficiles et nos sanglots occasionnels quand la pression devenait trop forte.
La nuit, les cauchemars nous visitaient avec une régularité implacable. Je me réveillais en hurlant, croyant sentir encore les mains sur mon corps, entendre les rires des officiers, voir les visages de mes sœurs disparues qui me regardaient avec des yeux accusateurs comme si j’étais responsable de leur mort. Louise me réveillait doucement, me serrait contre elle malgré sa propre faiblesse, murmurant des prières fragmentées qui n’avaient plus beaucoup de sens mais dont le rythme familier apportait un certain réconfort. Nous ne parlions presque jamais de ce qui s’était passé dans le camp. C’était comme si les mots eux-mêmes avaient été contaminés par cette expérience, comme si prononcer à voix haute ce que nous avions vécu risquait de le rendre encore plus réel, encore plus permanent dans nos mémoires déjà saturées d’horreur.
Un matin, environ deux semaines après notre évasion, alors que nous marchions le long d’un sentier forestier à peine visible, Louise s’effondra. Elle ne trébucha pas, elle ne glissa pas. Elle s’effondra simplement comme si les fils invisibles qui maintenaient son corps en mouvement avaient été coupés d’un coup. Je me suis agenouillée à côté d’elle, essayant de la relever, mais elle était brûlante de fièvre. Son corps tremblait de façon incontrôlable et ses yeux ne me reconnaissaient plus vraiment. Elle avait probablement contracté une pneumonie ou une autre infection que son système immunitaire affaibli ne pouvait plus combattre. J’ai tenté de la porter, de la traîner, mais j’étais moi-même si faible que je ne pouvais la déplacer que de quelques mètres avant de devoir m’arrêter. J’ai trouvé un endroit relativement abrité sous un grand chêne dont les racines formaient une sorte de niche naturelle, et je l’y ai installée du mieux que j’ai pu, couvrant son corps frissonnant avec des feuilles mortes et des branches pour la garder au chaud.
Je suis restée trois jours à ses côtés, refusant de l’abandonner, essayant de la faire boire, lui tenant la main pendant qu’elle délirait, parlant à des personnes qui n’existaient plus, revivant des moments de notre captivité dans un flux décousu de mots qui me brisèrent le cœur. Le troisième matin, au lever du soleil, elle ouvrit les yeux avec une clarté soudaine qui me donna un bref espoir. Elle me regarda directement et dit, d’une voix étonnamment ferme, qu’elle ne continuerait pas, que son corps avait atteint sa limite, mais que je devais continuer, que je devais survivre pour témoigner, pour que ce qui nous était arrivé ne soit pas oublié. Elle ferma les yeux, un léger sourire sur les lèvres, et s’éteignit doucement, sa respiration devenant progressivement superficielle jusqu’à cesser complètement. Je restai là, tenant sa main qui refroidissait progressivement, incapable de pleurer – il ne me restait plus de larmes. Incapable de bouger – je ne voulais pas accepter qu’elle était partie, que j’étais maintenant complètement seule.
J’ai enterré son corps du mieux que j’ai pu, creusant dans la terre meuble de la forêt avec mes mains nues jusqu’à ce que mes ongles se cassent et que mes doigts saignent, dans une clairière où le soleil perçait à travers les arbres, créant des motifs de lumière et d’ombre qui dansaient sur le sol. J’ai récité les prières funéraires que je connaissais encore par cœur, ma voix cassée résonnant étrangement dans le silence de la forêt, et j’ai marqué l’endroit avec des pierres disposées en croix pour que, peut-être un jour, quelqu’un puisse la retrouver et lui donner une sépulture décente. Puis j’ai continué seule, portant maintenant le poids non seulement de ma propre survie, mais aussi de la promesse que je lui avais faite de témoigner.
Les semaines suivantes devinrent un cauchemar hallucinatoire où je n’étais plus certaine de ce qui était réel et de ce qui relevait de mon esprit qui commençait à se fragmenter sous la pression. Je parlais à des personnes qui n’existaient pas. Je voyais des soldats allemands se révéler être des ombres d’arbres. J’entendais des voix qui m’appelaient mais qui n’étaient que le vent dans les feuilles. La faim était devenue une présence constante, une douleur sourde qui ne me quittait jamais, et mon corps maigrissait de jour en jour jusqu’à ressembler plus à un squelette ambulant qu’à un être humain. Mes vêtements déjà en lambeaux pendaient sur mon corps comme sur un épouvantail. Et quand je voyais mon reflet dans l’eau des ruisseaux, je ne me reconnaissais plus.
C’est dans cet état, en septembre, que je fus finalement trouvée par des résistants français qui opéraient dans cette région forestière. J’avais atteint les limites de mes forces. Effondrée au pied d’un arbre, incapable de continuer, j’attendais simplement la mort qui me semblait désormais la seule issue possible. Ils me trouvèrent par hasard lors d’une patrouille et, d’abord, ils crurent que j’étais déjà morte. Mais l’un d’eux remarqua que je respirais encore faiblement. Ils me portèrent jusqu’à leur camp caché profondément dans la forêt et là, une femme médecin qui travaillait avec eux tenta de me sauver. J’étais squelettique, couverte de plaies infectées qui suppuraient, délirante de fièvre.
Pendant plusieurs semaines, j’oscillai entre la vie et la mort dans des conditions médicales extrêmement précaires, avec peu de médicaments et encore moins d’équipement. La femme médecin, dont je n’ai jamais su le vrai nom mais qui se faisait appeler Marie, m’a soignée avec une détermination remarquable, changeant mes pansements infectés, me forçant à boire même quand j’étais inconsciente, me parlant constamment pendant mes moments de délire pour me maintenir accrochée à la vie. Quand j’ai finalement repris conscience de façon stable, c’était déjà fin septembre. La guerre touchait à sa fin, même si personne ne le savait encore avec certitude. Hitler était encore en vie, l’Allemagne combattait encore, mais le front se rapprochait inexorablement. Les Alliés progressaient sur tous les fronts et même dans notre cachette forestière, nous pouvions sentir que quelque chose de fondamental était en train de changer.
Les résistants m’ont gardée avec eux jusqu’à ce que la région soit libérée en octobre par les forces américaines. Et c’est alors que j’ai été transférée vers un hôpital de campagne américain installé dans une ville récemment libérée. Là, pour la première fois depuis plus d’un an, j’ai dormi dans un vrai lit, mangé de la vraie nourriture et été traitée par des médecins ayant accès à des antibiotiques et à d’autres médicaments modernes qui ont finalement vaincu les infections qui me consumaient de l’intérieur. Mais guérir le corps était une chose ; guérir l’esprit en était une autre complètement différente. Les cauchemars continuaient, encore plus intenses maintenant que je n’étais plus dans un état de survie constant qui les supprimait par nécessité. Je me réveillais en hurlant chaque nuit, terrorisant les autres patients et les infirmières qui ne comprenaient pas ce qui m’arrivait.
Un psychiatre militaire américain, un homme d’une cinquantaine d’années au visage bienveillant, parlant un français correct, tenta de me faire parler de ce que j’avais vécu. J’ai essayé, vraiment essayé. Mais les mots se coinçaient dans ma gorge. Ils refusaient de sortir comme si mon corps lui-même résistait à la verbalisation de l’horreur. Je lui racontais des fragments, des morceaux épars de l’histoire, mais jamais l’ensemble, jamais les détails les plus sombres, qui restaient enfouis profondément en moi où personne ne pouvait les atteindre. Il diagnostiqua ce qu’on appelait à l’époque une « névrose de guerre », un terme inadéquat pour décrire la destruction psychologique complète que représentait ce que nous avions vécu.
Aujourd’hui, alors que je m’approche de la fin de ma vie, je regarde en arrière et me demande ce qui reste d’une personne après qu’on lui a tout pris. Mon corps porte encore les cicatrices, certaines visibles, d’autres invisibles, mais toutes aussi profondes. Je n’ai jamais pu avoir d’enfant, non seulement à cause des dommages physiques subis, mais surtout parce que l’idée même de l’intimité, de la vulnérabilité, du toucher me terrifiait au-delà de toute expression. Je n’ai jamais connu l’amour romantique, jamais partagé ma vie avec quelqu’un, jamais eu cette famille que tant de gens considèrent comme normale. Ma vie a été une existence solitaire, marquée par le travail, le silence et cette vigilance constante, cette impossibilité de me détendre complètement même dans les moments les plus sûrs.
Mais j’ai survécu. Et cette survie, aussi douloureuse soit-elle, est une forme de résistance. Chaque jour que j’ai vécu après la guerre, chaque matin où je me suis réveillée, chaque respiration que j’ai prise était une victoire contre ceux qui voulaient nous effacer complètement. Ils ont pris tant de choses, ils ont détruit tant de ce que j’étais, mais ils n’ont pas réussi à m’anéantir totalement. Une petite partie de moi, minuscule mais indestructible, a continué à exister. Malgré tout, la foi, ce pilier central de ma vie avant la guerre, ne s’est jamais vraiment rétablie comme auparavant. Je ne peux plus croire en un Dieu qui intervient directement, qui protège les innocents, qui récompense la vertu. Ce Dieu-là est mort pour moi dans ce baraquement sombre où nous priions sans être entendues. Mais une forme différente de spiritualité a émergé avec les années. Quelque chose de plus humble, de plus terrestre : une reconnaissance de la capacité humaine à la fois pour le mal absolu et pour une compassion extraordinaire. J’ai vu les deux extrêmes. J’ai expérimenté la cruauté la plus systématique et, parfois, de petits gestes de bonté inattendus : un garde qui détournait le regard pour nous laisser voler un morceau de pain, un prisonnier qui partageait sa maigre ration, une infirmière après la guerre qui tenait ma main pendant les cauchemars sans poser de questions. Ces moments minuscules de lumière dans l’obscurité totale sont ce qui m’a permis de continuer, de croire que l’humanité, malgré tout, valait quelque chose.
Je pense souvent à mes sœurs disparues, à leurs visages, à leurs voix, à leurs rires d’avant. Sœur Marie-Thérèse qui chantait si magnifiquement pendant les offices. Sœur Bernadette qui racontait des histoires drôles pour faire rire les enfants orphelins. Sœur Marguerite qui était stricte mais juste, qui nous apprenait la discipline et la dignité. Elles méritaient de vivre longtemps, d’avoir des vies pleines, de vieillir en paix entourées de respect et d’amour. Au lieu de cela, elles ont été brisées, jetées, oubliées. Leur seul crime était de porter un habit qui les identifiait comme religieuses, d’incarner une pureté qui dérangeait, qui devait être souillée pour prouver qu’aucune valeur n’était sacrée dans ce monde en guerre.
Les années qui ont suivi la guerre ont vu l’émergence de nombreux témoignages sur les camps de concentration, sur les chambres à gaz, sur les expériences médicales, sur toutes les horreurs que le régime nazi avait perpétrées. Mais certaines catégories de victimes sont restées dans l’ombre. Leurs histoires étaient jugées trop embarrassantes, trop spécifiques, trop dérangeantes pour être intégrées dans le grand récit de la mémoire collective. Les femmes violées systématiquement, les religieuses utilisées comme objets sexuels, les prisonnières dont la souffrance n’était ni industrialisée ni documentée avec la précision bureaucratique des autres atrocités. Nous sommes restées des notes de bas de page, des anecdotes mentionnées brièvement puis rapidement oubliées. Ce silence a été une deuxième violence, une négation de notre expérience, un message implicite que ce qui nous était arrivé n’était pas aussi important, pas aussi digne de mémoire que d’autres souffrances. Et pourtant, notre histoire fait partie intégrante de la compréhension de ce qu’a réellement été la guerre, de la manière dont le pouvoir absolu corrompt absolument, de la façon dont la déshumanisation permet tous les crimes.
En témoignant aujourd’hui, si tard dans ma vie, j’espère contribuer, même modestement, à combler cette lacune historique, à rendre visibles celles qui ont été effacées, à donner une voix à celles qui n’ont plus la possibilité de parler. On me demande souvent quand on apprend mon histoire : « Est-ce que vous avez pardonné ? » C’est une question complexe, chargée d’attentes morales et religieuses. On attend d’une ancienne religieuse qu’elle pardonne, que sa foi transcende la haine, que la miséricorde l’emporte sur la vengeance. Mais le pardon, tel que je le comprends maintenant, n’est pas un bouton sur lequel on appuie, un choix simple qu’on fait une fois pour toutes. C’est un processus, une lutte quotidienne, un équilibre précaire entre la reconnaissance de l’humanité fondamentale même chez les bourreaux et le refus absolu d’excuser l’inexcusable.
Je ne pardonne pas les actes, jamais, car les pardonner serait diminuer leur gravité, suggérer qu’ils étaient acceptables ou compréhensibles dans leur contexte. Mais j’ai appris très lentement et douloureusement à ne pas laisser la haine consumer le peu de vie qu’il me restait. Porter la haine éternellement, c’est permettre aux bourreaux de continuer à me détruire des décennies après les faits. Alors j’ai choisi, autant que possible, de me concentrer sur la survie, sur la reconstruction, sur la transmission de la mémoire plutôt que sur la vengeance. Ce n’est pas du pardon, c’est de l’autoconservation.
Quand je mourrai bientôt, car mon corps est usé et fatigué, j’emporterai avec moi toute cette douleur, toute cette mémoire, tous ces fantômes qui m’ont accompagnée pendant plus de six décennies. Mais je laisserai aussi ce témoignage, ces mots enregistrés, cette histoire racontée enfin sans filtre ni censure. J’espère qu’elle servira à quelque chose, qu’elle empêchera peut-être quelqu’un quelque part de croire que la guerre est glorieuse, que la déshumanisation de l’autre est jamais justifiable, que certaines personnes peuvent être traitées comme moins qu’humaines sans conséquences morales catastrophiques.
L’histoire a tendance à se répéter quand on ne l’étudie pas honnêtement, quand on oublie les détails gênants, quand on préfère les récits simples aux vérités complexes. Mon histoire n’est pas simple. Elle n’offre pas de résolutions satisfaisantes. Elle ne se termine pas par un triomphe clair du bien sur le mal. Elle se termine par une vieille femme seule qui a survécu mais n’a jamais vraiment guéri. Qui a continué à vivre mais n’a jamais retrouvé la joie innocente qu’elle connaissait avant. C’est une fin honnête, et dans cette honnêteté réside peut-être la seule forme de vérité que je peux offrir. La guerre ne crée pas seulement des morts, elle crée aussi des survivants brisés qui portent leurs blessures invisibles jusqu’à la tombe. Et ces blessures font partie du coût réel des conflits que l’humanité continue de déclencher avec une régularité déprimante.
Ma dernière pensée, celle que je souhaite laisser à ceux qui écouteront cette histoire, est plus une question qu’une réponse. Combien de temps faut-il à une société pour oublier complètement les leçons du passé, pour recommencer à déshumaniser certains groupes, pour justifier la violence au nom d’idéologies qui promettent un monde meilleur en éliminant ceux qui sont jugés impurs, dangereux ou simplement différents ? Si l’histoire nous enseigne quelque chose, c’est qu’il faut beaucoup moins de temps qu’on ne le croit : une génération, parfois deux. Et les mêmes mécanismes psychologiques qui ont permis les horreurs de la Seconde Guerre mondiale recommencent à opérer sous de nouvelles formes, dans de nouveaux contextes. C’est pourquoi témoigner, se souvenir, raconter, même lorsque c’est douloureusement difficile, n’est pas un luxe mais une nécessité absolue. Parce que le silence, l’oubli, la négation sont les meilleurs alliés de ceux qui voudraient répéter l’histoire. Chaque voix qui se lève pour dire « Cela s’est passé, je l’ai vécu, c’était réel » est un rempart fragile mais essentiel contre le retour de la barbarie.
L’histoire de Jeanne Vin ne se termine pas avec sa survie. Elle continue dans chaque mot que vous venez d’entendre, dans chaque image que votre esprit a créée, dans chaque moment de silence qui s’est installé pendant que vous processiez l’impensable. Ce n’est pas seulement l’histoire d’une femme qui a survécu à l’enfer. C’est l’histoire de quinze femmes qui ont été choisies, marquées, détruites simplement parce qu’elles représentaient quelque chose que des hommes cruels voulaient profaner. C’est l’histoire de milliers d’autres victimes dont nous ne connaîtrons jamais les noms, dont les voix ont été réduites au silence pour toujours, dont les expériences ont été enterrées parce que la société de l’après-guerre a préféré oublier plutôt que d’affronter la vérité complète.
Jeanne a passé soixante-deux ans à porter ce fardeau seule, vivant dans le silence, cachant ses cicatrices invisibles tandis que le monde autour d’elle se reconstruisait et célébrait la victoire. Elle n’a pas eu de famille, elle n’a pas connu l’amour. Elle n’a pas expérimenté la paix que tous méritent après avoir survécu à l’inimaginable. Sa seule victoire fut de continuer à respirer, de continuer à exister, de refuser de laisser ses bourreaux avoir le dernier mot. Et à la fin de sa vie, quand son corps fragile n’avait plus de force mais que sa mémoire restait intacte et implacable, elle a décidé de parler. Pas par vengeance, pas par haine, mais parce qu’elle savait que le silence serait leur dernière victoire. Parce qu’elle savait que lorsque nous effaçons ces histoires, lorsque nous préférons les récits confortables aux vérités dérangeantes, nous créons l’espace pour que la violence revienne sous de nouvelles formes.
Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait vous arrêter et réfléchir sur ce dont les êtres humains sont capables lorsque les structures civilisationnelles s’effondrent, alors vous avez une responsabilité : celle de ne pas oublier, de ne pas laisser des histoires comme celles de Jeanne être enterrées à nouveau dans le confort de l’oubli collectif. Chaque visualisation, chaque commentaire, chaque partage est un acte de résistance contre l’oubli. C’est une façon d’honorer non seulement Jeanne, mais toutes les victimes anonymes dont les histoires ne seront jamais racontées, dont les noms se sont perdus dans le chaos de la guerre, dont les expériences ont été délibérément effacées parce qu’elles révélaient des vérités trop dérangeantes sur la déshumanisation systématique et le pouvoir absolu.
La dernière question que Jeanne a laissée résonne au-delà de sa mort, exigeant que chaque génération y réponde à nouveau. Combien de temps faut-il à une société pour oublier complètement les leçons du passé et commencer à répéter les mêmes erreurs sous de nouveaux drapeaux, avec de nouvelles justifications, mais avec la même logique destructrice ? La réponse est entre nos mains. Elle réside dans notre choix de nous souvenir ou d’oublier, de confronter ou d’ignorer, de transmettre ces histoires aux prochaines générations ou de les laisser mourir avec nous. Jeanne a accompli sa part. Elle a parlé quand il était plus facile de rester silencieuse. Elle a témoigné quand le témoignage coûtait de revivre chaque moment de tourment. Maintenant, il nous appartient de garantir que son témoignage n’a pas été vain, que les mots qui lui ont tant coûté à prononcer ne se perdent pas dans le bruit infini de l’ère numérique, mais trouvent des oreilles disposées à écouter et des cœurs prêts à porter en avant le poids sacré de la mémoire.