
Il nous choisissait pour notre pureté, pas pour notre force, pas pour des informations, pas pour notre utilité. Pour notre pureté, comme si…

Charleston. La salle d’audience sentait la sueur et la peur. Le juge Nathaniel Ashford siégeait derrière son imposant bureau en acajou, sa perruque…

Imaginez-nous en l’an 722 de notre ère. Vous êtes un général du califat omeyyade. Vous venez de conquérir le monde connu, des sables…

En 1347, une femme nommée Béatrice s’agenouille dans un confessionnal à Florence. Le prêtre lui pose une question qui ne porte pas sur…

Imaginez la scène : nous sommes le 10 novembre 1444. Vous avez 20 ans, vous êtes roi et vous venez de commettre une…

En 1968, les cris d’une femme ont résonné dans les couloirs d’un prestigieux hôpital américain pendant 72 heures consécutives. Les infirmières suppliaient les…

Imaginez ceci. Vous êtes un espion persan accroupi dans les rochers au-dessus des Thermopyles. Nous sommes en 480 avant J.-C. Vous avez été…

On les appelait les servantes de Dieu, des femmes qui avaient consacré leur vie à la prière, aux soins des malades et à…
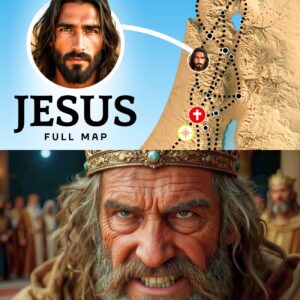
Nous sommes en 5 avant J.-C. et Jésus vient au monde dans une petite ville appelée Bethléem, dans l’Israël antique. Vous pensez probablement…
